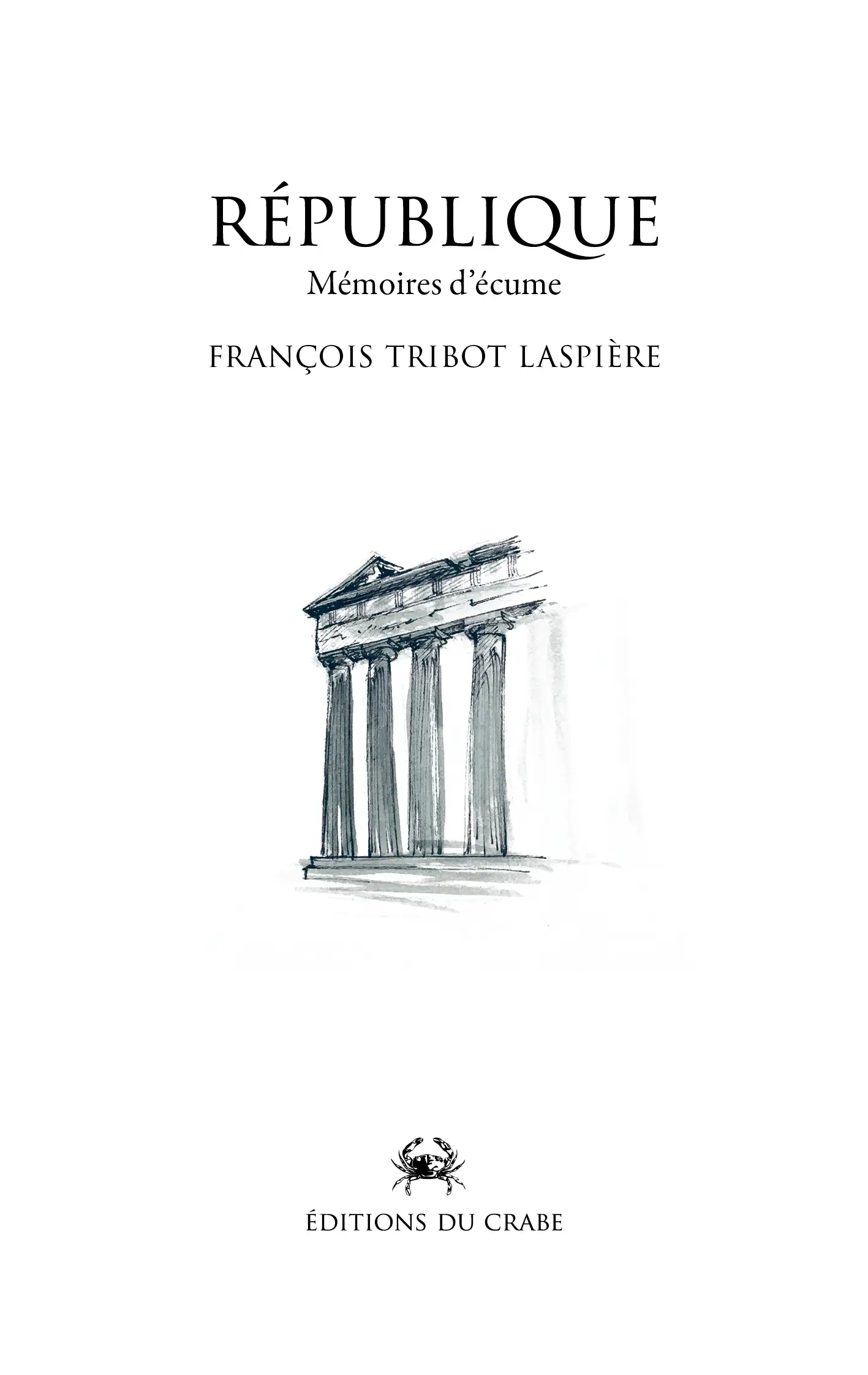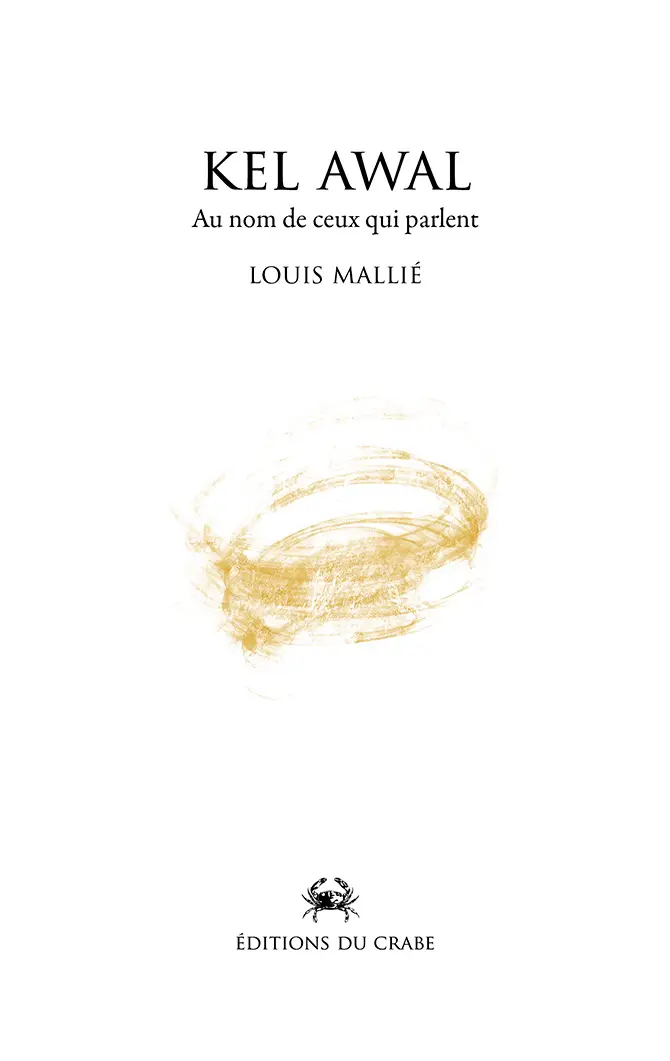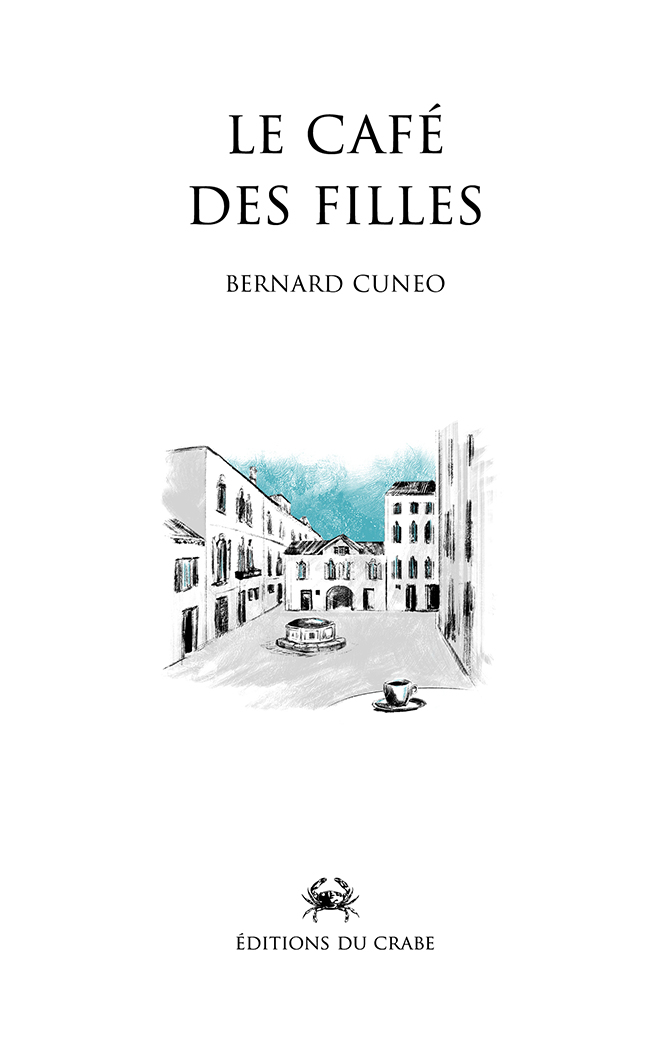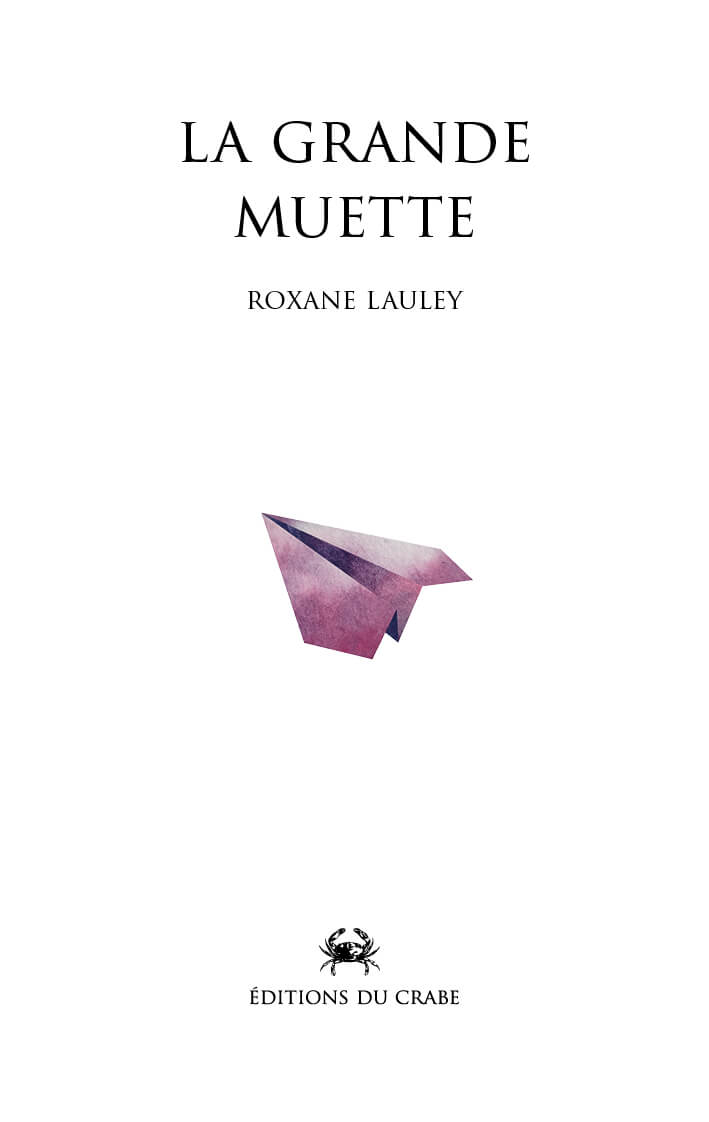Le temps de l’hiver convient à mes promenades artistiques. En ce matin de janvier, j’avance lentement à la recherche d’un tableau de Murillo. Les grandes salles sont vides et silencieuses, et le battement de mon pas sur les parquets résonne dans les galeries. J’entre dans la pièce réservée au Sévillan, à ses scènes tragiques et touchantes.
Dans un angle, assis, voûté devant son chevalet, le bras levé, comme attendant l’inspiration, il est en train de copier le maître baroque. À mon approche, il ne manifeste aucune réaction et poursuit son geste immobile. Un gardien, à l’autre bout de la salle, fait sa ronde monotone et triste.
Cano.
Il est là, figé dans sa recherche d’exactitude et de vérité, concentré sur sa volonté inébranlable de reproduction de l’œuvre, appliqué devant le maître, dans une attitude fixe que rien ne doit venir distraire. Il ne m’a pas vu, pas entendu. Le présent lui échappe, il n’y a pas accès. Seule compte l’invisible ligne qui relie son regard brûlant aux courbes et aux couleurs du modèle. Je suis resté un moment à le voir hésiter, trembler, oser poser la soie de son pinceau sur le support rêche et sec, à reprendre et regretter, puis à se décider enfin à fixer son sujet dans le décor naissant.
Je suis parti sans rendre visite à Murillo. Je l’ai laissé avec son imitateur. Qu’en pense-t-il, Bartolomé Estéban, de ce copiste méticuleux et appliqué ? Admire-t-il sa fidèle dextérité, la justesse de son exécution, qui remplace son imagination ? Regrette-t-il de ne pas le voir peindre ses propres modèles au lieu de lui voler les siens ? Mais Bartolomé Estéban reste coi, se contentant d’avoir livré à la postérité le talent que la nature lui avait offert.
Je sais que l’on apprend parfois en copiant, c’est le chemin de l’artiste. Mais si l’on ne fait que copier, est-on encore peintre ? Peu me chaut que Cano ne fasse que reproduire, c’est son choix. Mais reproduire n’est pas créer, c’est faire à nouveau ce qui a déjà été fait. C’est refaire, mais sans l’âme.