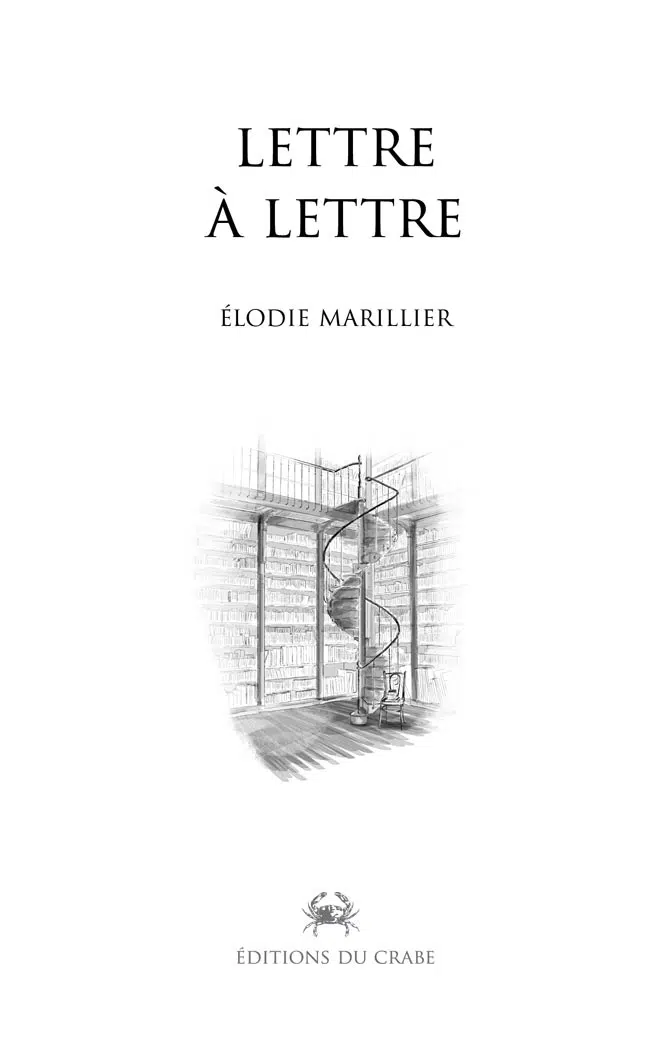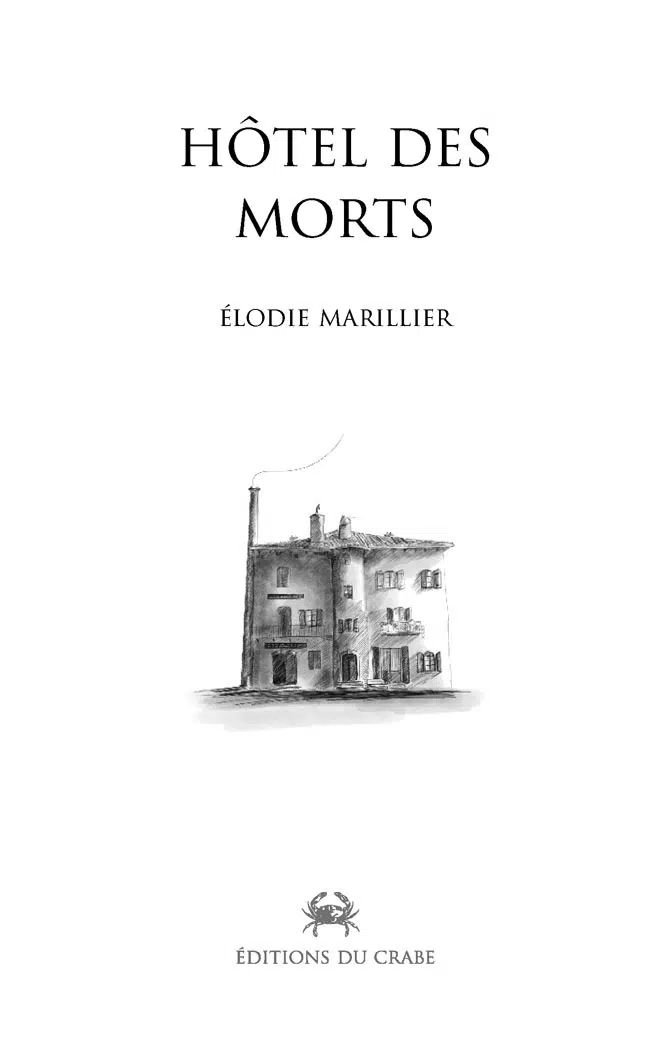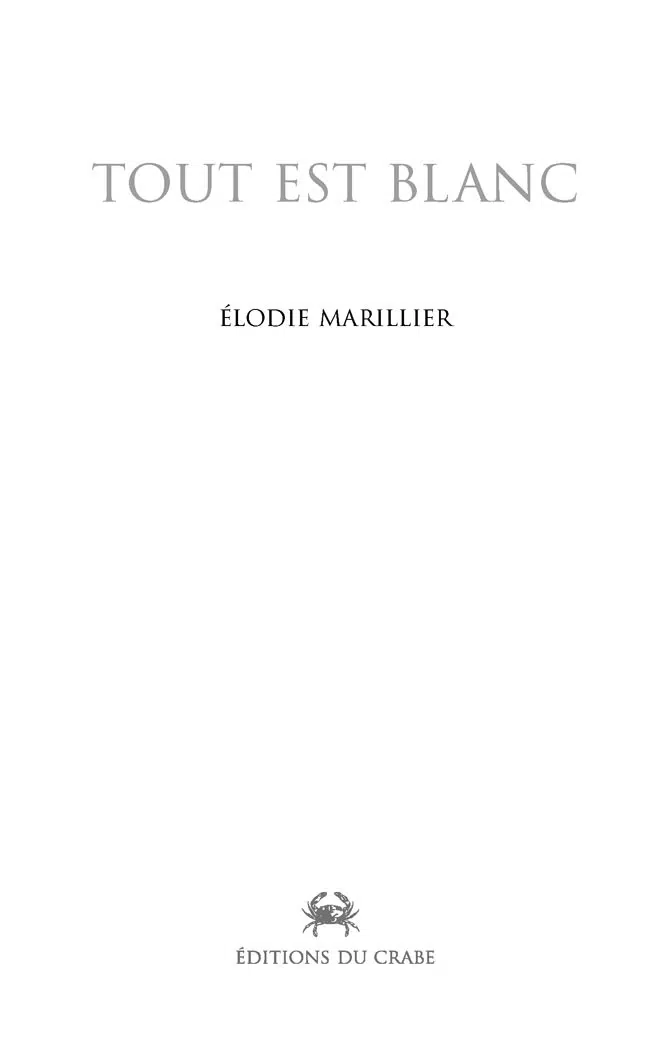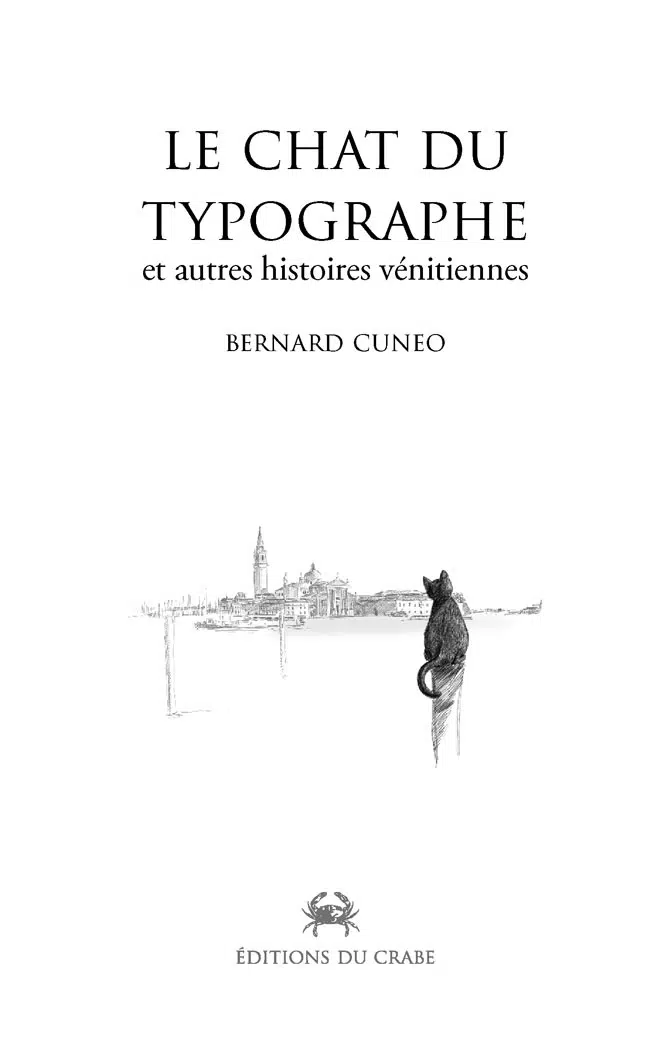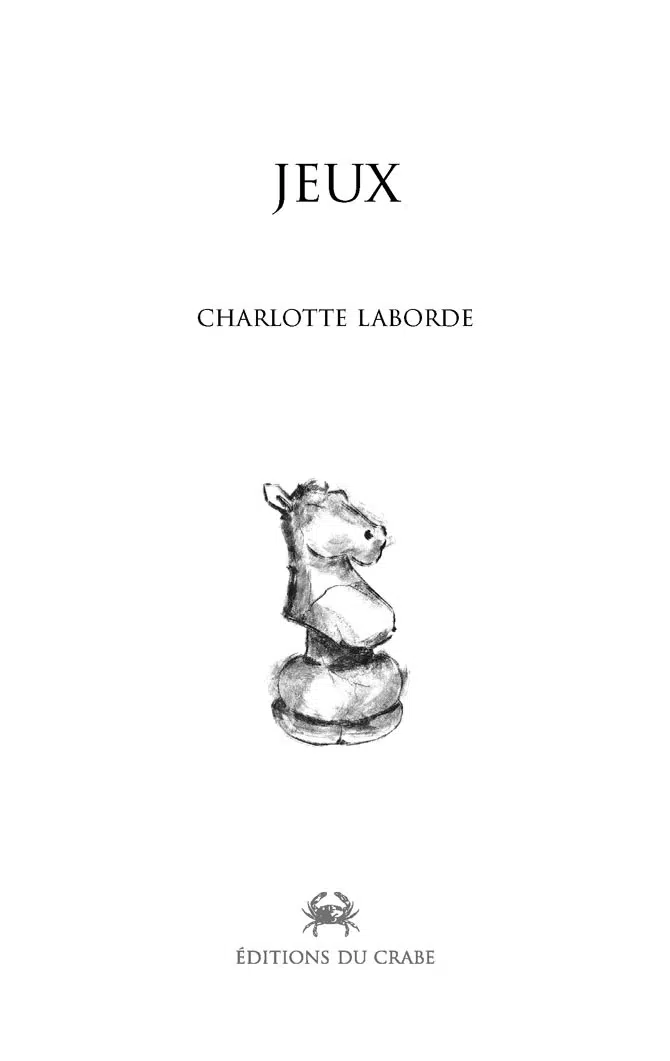Lettre à Lettre
élodie marillier
Au commencement est anacoluthe, terme non point barbare mais qui désigne cette chose d’essence linguistique inscrite au grand registre des figures de style. Puis il faut dire surtout que ce n’est pas hasard de la voir ici au début, car si le mot accueille bien le lecteur, la figure sera elle tout du long sa compagne – s’il acceptait bien sûr de faire le tour de cet ouvrage et donc aussi cette invitation à entrer, lancée là depuis la quatrième de sa couverture.
Des textes courts de haute fantaisie, dans un désordre aléatoire. Au fil des mots la langue se fait belle, et nous parle du monde.
Il y a des mots paquebots, lourds de sens en vrac, et qui vont un peu partout. Dans ces pages, l’auteure leur donne un contenu et une direction, qu’elle nous propose de suivre à notre tour. C’est un dictionnaire de traces, d’émotions, et d’images.