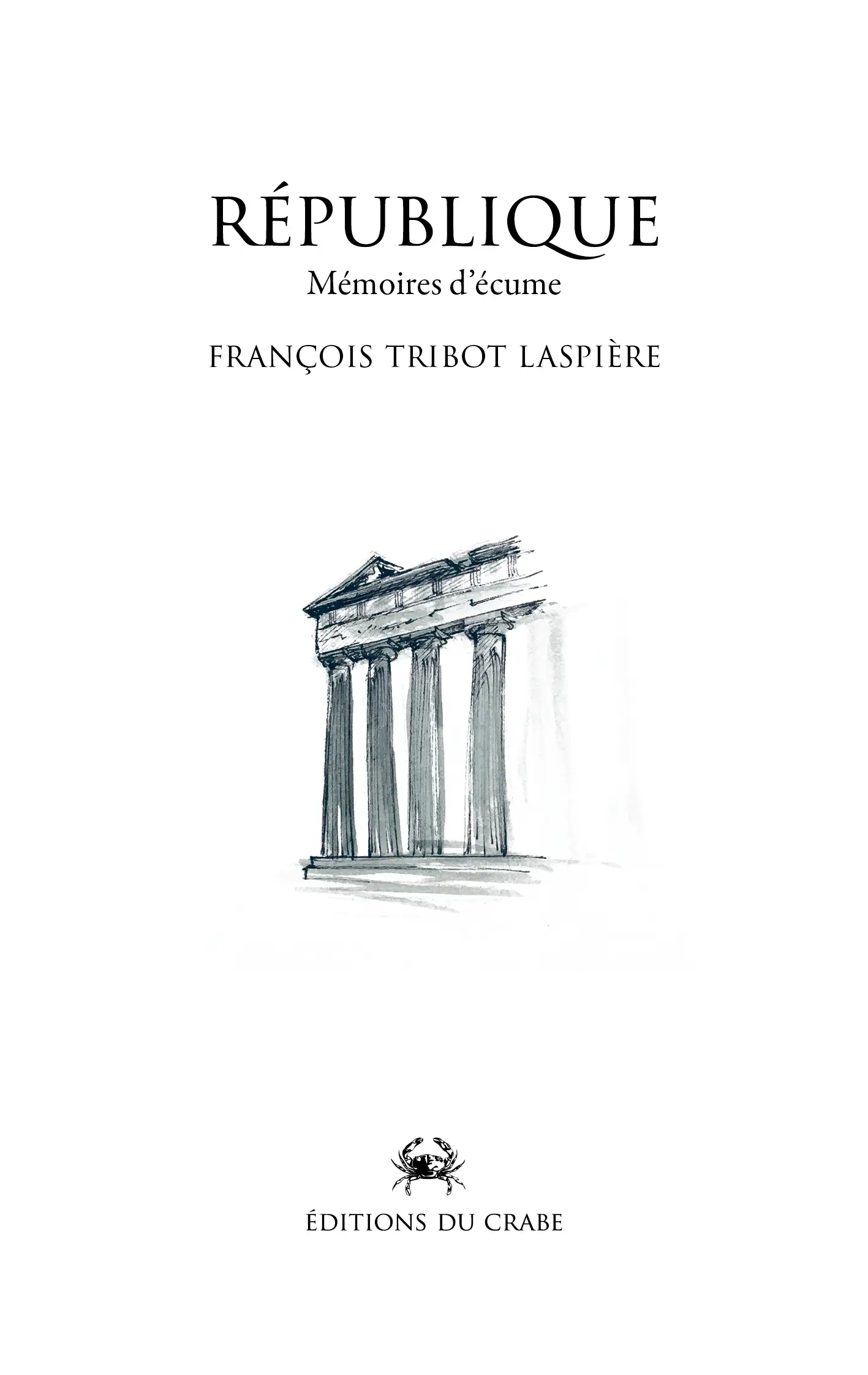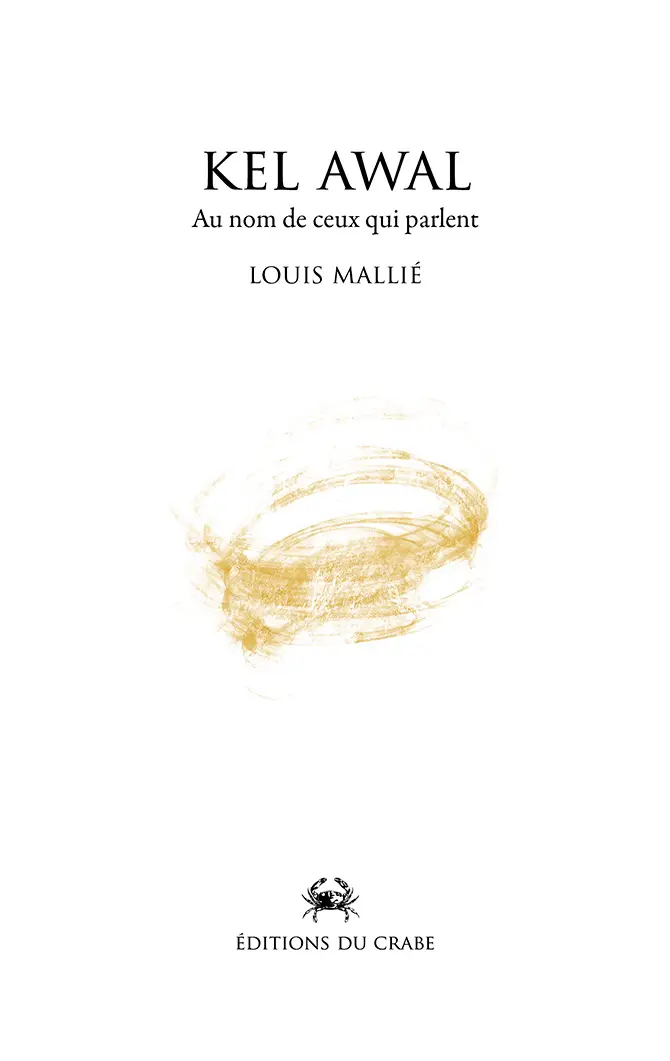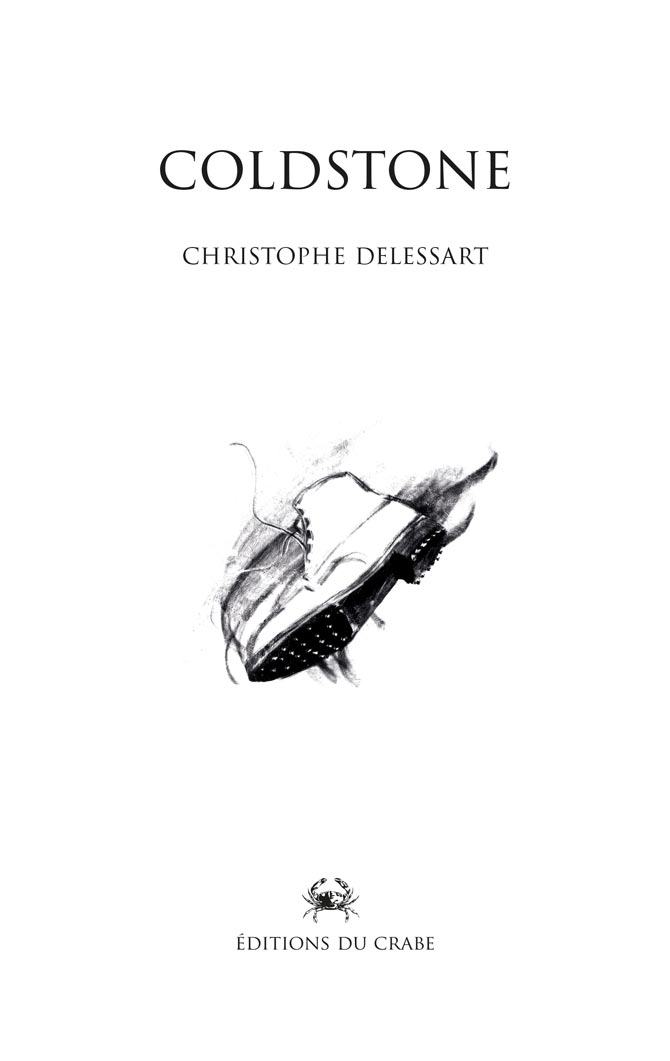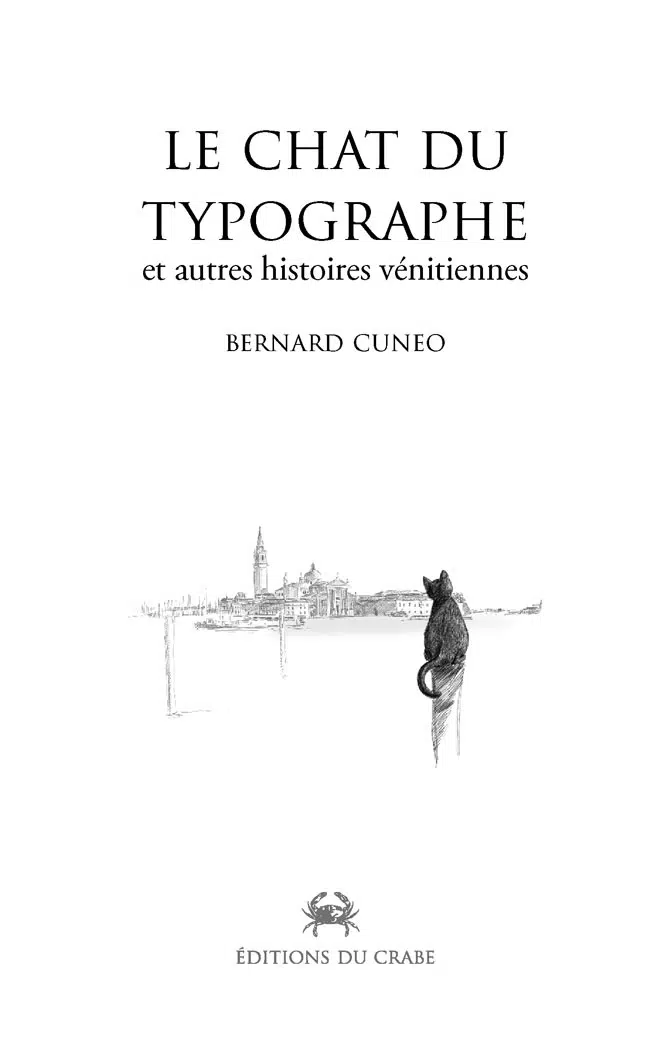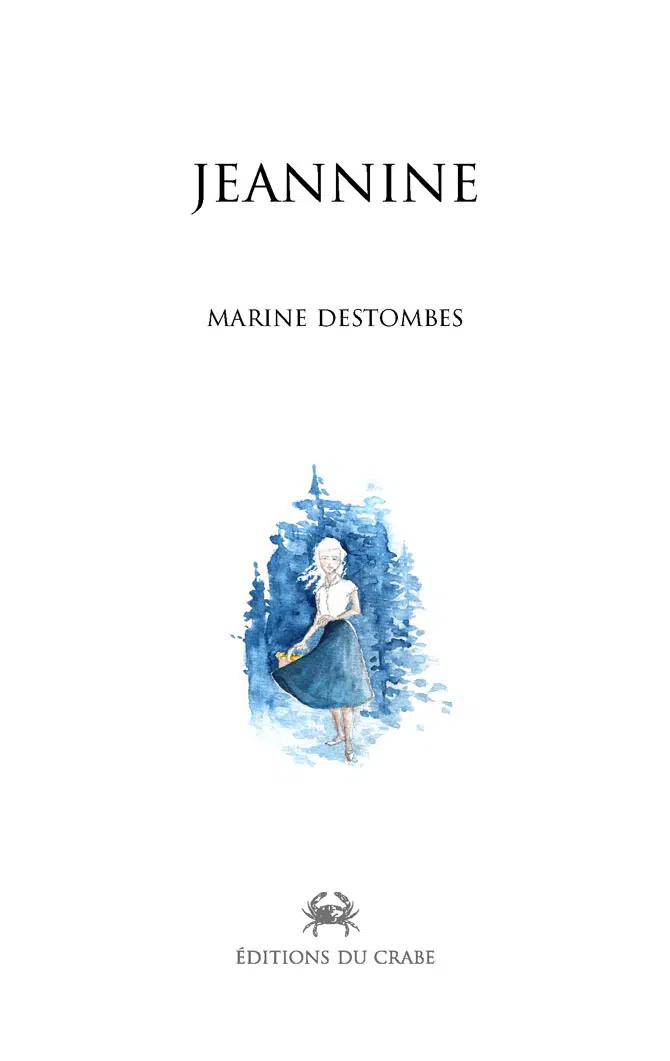En cette fin février, Sainte-Eulalie de Landonne, petite commune de Guyenne, si petite que les cartes ne la mentionnaient que d’une timide italique, sortait doucement de sa torpeur. La douceur des hivers aquitains la protégeait de l’hibernation et des amplitudes thermiques. La morte-saison glissait lentement sur les terroirs. C’était la saison des travaux agricoles d’entretien, de la restauration des bâtiments fatigués, de la réparation des machines et des outils assoupis dans les granges et sous les préaux : tracteurs, moissonneuses-batteuses, vendangeuses, lourdes remorques, petits matériels. Pendant que la nature se reposait, les hommes préparaient les futurs travaux.
C’était aussi le moment des pèle-porcs, des charcutailles, des conserves, des vinifications. À la campagne, chaque saison avait toujours un temps d’avance sur la suivante. Hommes, bêtes et territoires marquaient lentement les jours, dans l’air atone d’une saison qui semblait ne pas devoir finir.
Seules, en apparence, les usines de la contrée poursuivaient leur vie régulière. De plaines en coteaux, des filets de fumée blanche rejoignaient le ciel changeant et animaient l’horizon. Les entreprises installées dans la communauté de communes généraient matin et soir un flux de circulation, rubans de lumière rouges et blancs projetés dans l’obscurité des petites routes.
Les deux écoles et le collège situés à l’entrée du bourg assuraient le réveil communal. Cris d’enfants, pleurs et bruits de portières claquées déchiraient la nuit finissante. La boulangerie avait déjà ouvert ses portes, des parfums de pain chaud traversaient la place centrale et, comme un Angélus, secouaient délicieusement les derniers dormeurs. L’Angélus, justement : il était huit heures, et les cloches de Saint-Paterne achevaient les récalcitrants.
Ainsi allaient les jours d’hiver, dans la commune de Sainte-Eulalie de Landonne. C’était ma ville. J’y avais mes habitudes, ma vie et mon travail.
J’étais entrepreneur. Je pourrais dire : patron d’une petite entreprise de fabrication de composants spéciaux destinés à l’industrie mécanique, que j’avais créée vingt-cinq ans plus tôt. Les collectivités locales, aidées par l’État, incitaient alors les investisseurs à s’implanter sur ces territoires essentiellement agricoles, cherchant ainsi à diversifier l’activité, donc les ressources et le développement des communes. Je n’avais pas hésité longtemps. Bordeaux était à quelques encablures, l’endroit plutôt agréable, les moyens de transport nombreux, la main-d’œuvre qualifiée disponible dans une proximité acceptable. Que pouvais-je espérer de plus ? J’avais réalisé qu’au-delà des simples critères économiques, le choix de l’environnement était déterminant. Étais-je déjà, au fond, un entrepreneur « écolo » ? De tout cela je parlerais, bien des années plus tard, avec un président de l’Assemblée nationale, écologiste.
La vie de chef d’entreprise n’était peut-être pas une vocation, mais elle était déjà un sacerdoce. Faire et assumer des choix stratégiques, prendre des décisions d’investissement qui engagent l’entreprise sur le moyen et le long terme, prendre en compte une instabilité fiscale qui varie selon les humeurs du législateur et des rédacteurs des projets de lois de finances, anticiper les évolutions de la demande et de la concurrence, garder le cap, gérer la ressource essentielle qu’est le personnel, étaient des défis stimulants et dynamisants. Mais ils apportaient bien des nuages dans le ciel bleu de la croissance et de l’évolution du chiffre d’affaires.
Parmi les choix quotidiens, techniques, financiers, d’organisation, ceux qui m’avaient paru les plus exigeants, les plus importants, les plus sensibles, étaient ceux qui concernaient les premiers acteurs de l’entreprise : ouvriers, contremaîtres, comptables, etc. Recruter des professionnels, assurer leur formation régulière, leurs évolutions – ce qui n’était pas simple dans une petite entreprise –, gérer les erreurs, stimuler les efforts, récompenser les succès : voilà qui requérait discernement, patience, résilience, optimisme, et surtout courage. Du courage, on en manquait toujours un peu. Comme ailleurs.
Acteur économique, l’entrepreneur n’évitait pas d’être un acteur social. Si celui qui créait l’emploi, qui acquittait les impôts auprès des collectivités, qui tissait la toile d’un territoire, n’avait pas conscience de cette responsabilité, il ne s’inscrivait pas durablement dans la vie locale. J’avais appris cela très tôt. Le maire de Sainte-Eulalie durant tant d’années, Charles Bousserolles, s’était chargé de m’en convaincre. Demandes de soutien à un concours de pêche, sollicitations de petites dotations par l’association des retraités ou mise à disposition par la commune d’équipements techniques : tout était précieux et contribuait, modestement, à tisser ce qu’il était devenu chic de nommer du « lien social ». Les élus savaient, en général, apprécier cela. Un jour, un de mes collègues, sénateur de la région, avait répondu au représentant d’un grand groupe qui lui avait octroyé quelques milliers d’euros pour son club de rugby « qu’il ne demandait pas la charité, qu’il attendait beaucoup plus, et qu’il ne renverrait pas l’ascenseur ». Il commettait davantage qu’une faute : une erreur. Il fut d’ailleurs plus tard mis en cause pour corruption et cessa de hanter, de sa silhouette condescendante, les couloirs du Sénat.
Charles Bousserolles avait insensiblement, mais sans doute volontairement et de manière subliminale, commencé à susciter chez moi un intérêt croissant pour la vie de la collectivité.
C’est ainsi qu’un soir de printemps, à l’approche des élections municipales, le téléphone sonna : Charles Bousserolles, maire sortant sans étiquette, me demandait de faire partie de sa liste, en position éligible. Je ne réfléchis pas vraiment et lui répondis que oui, bien sûr, il pouvait compter sur moi.