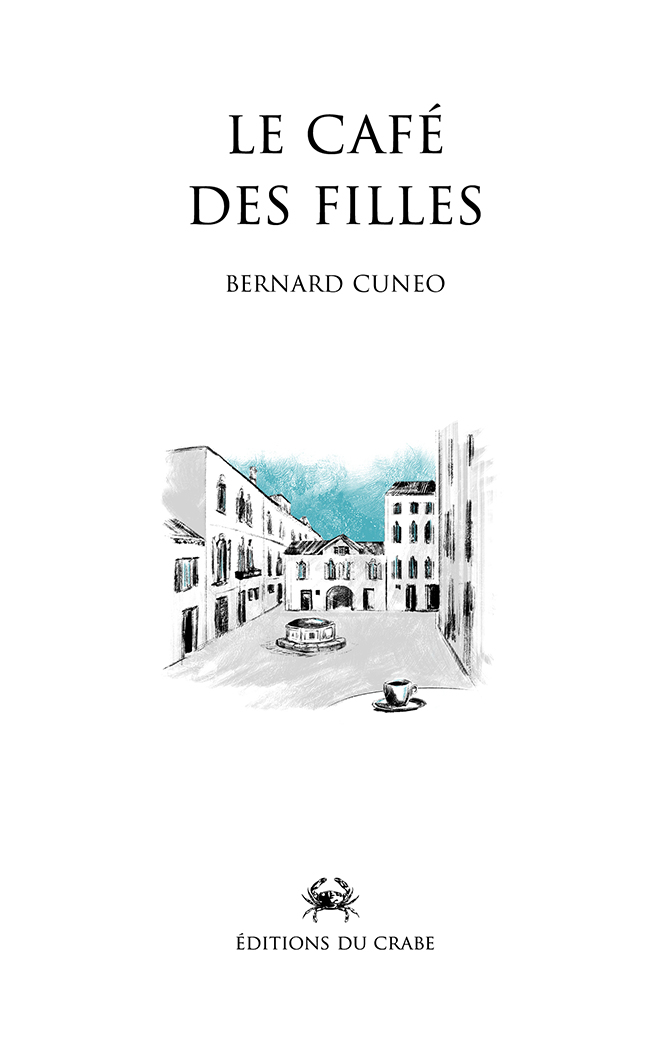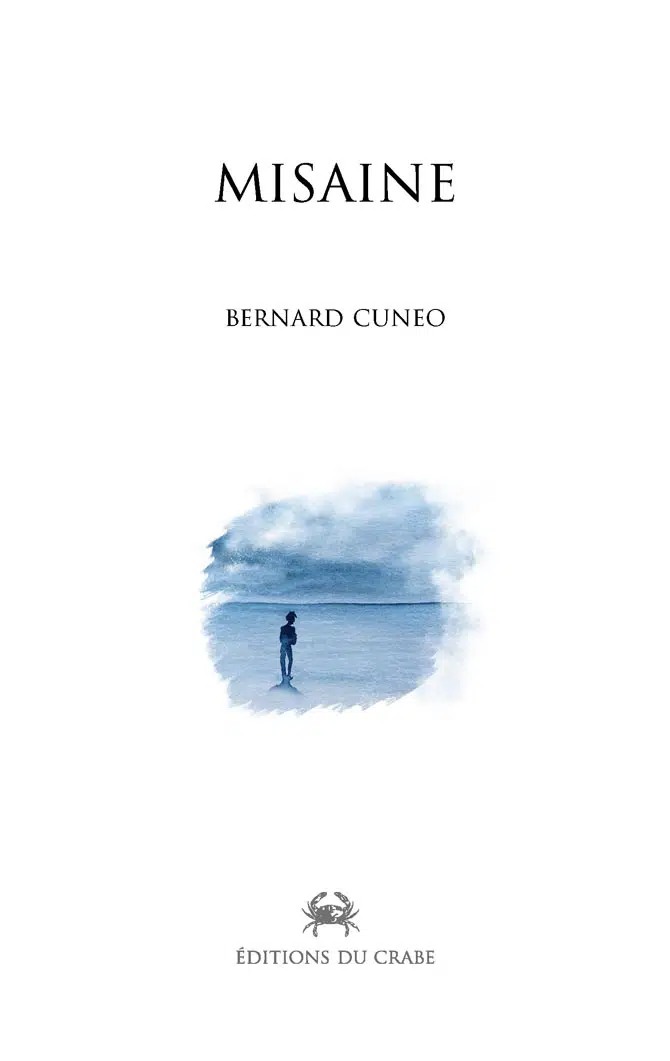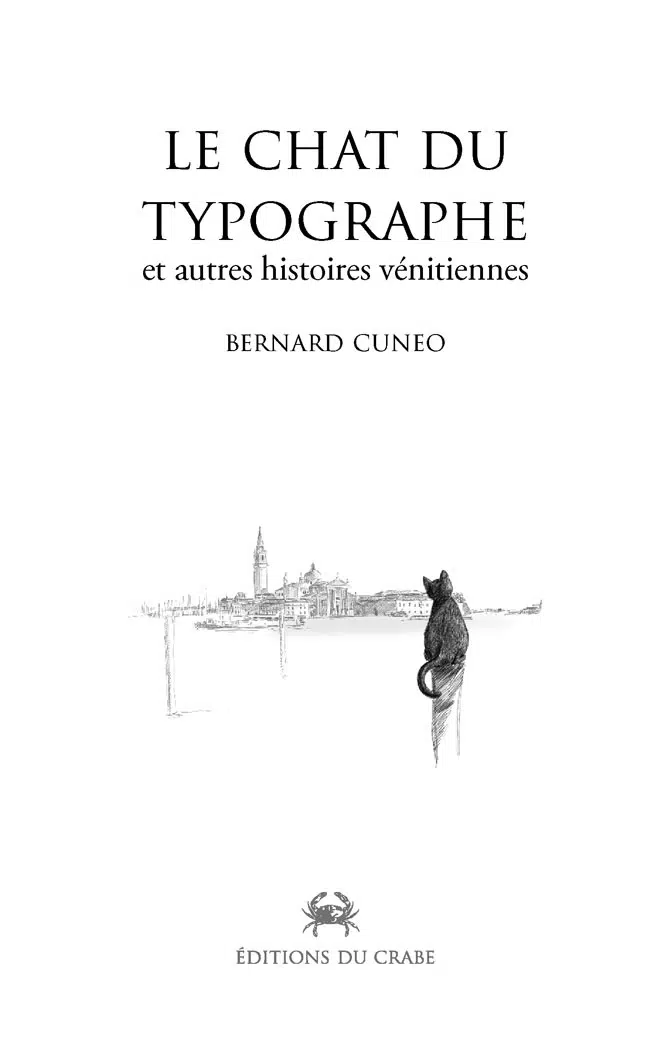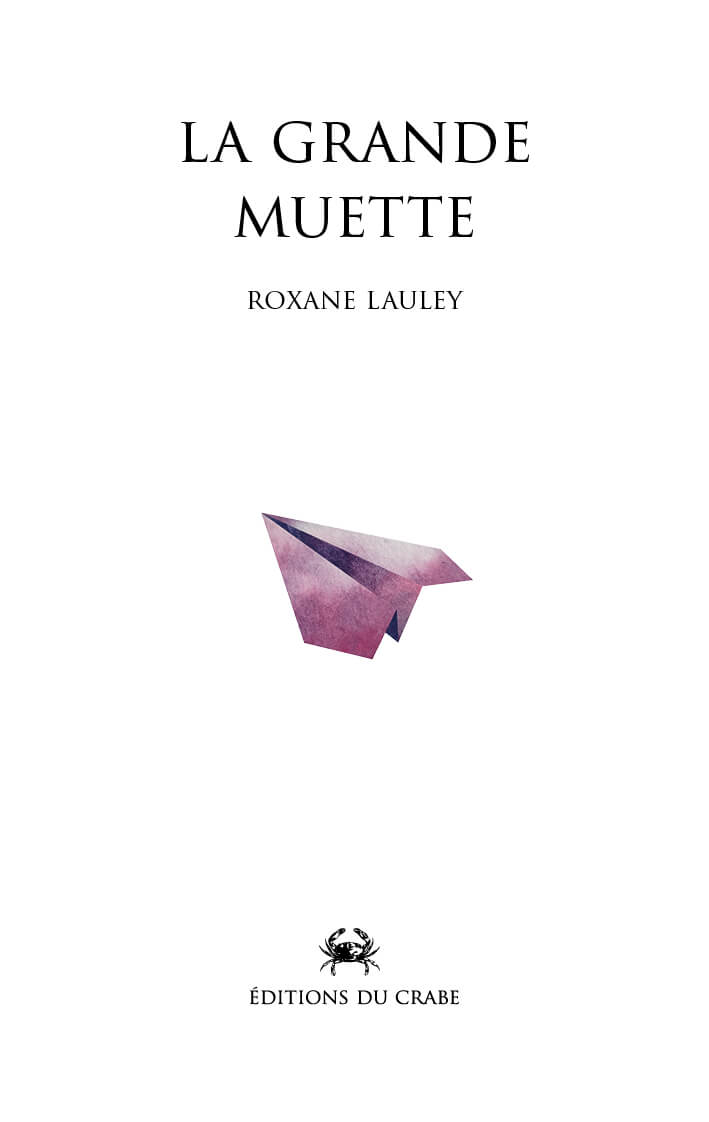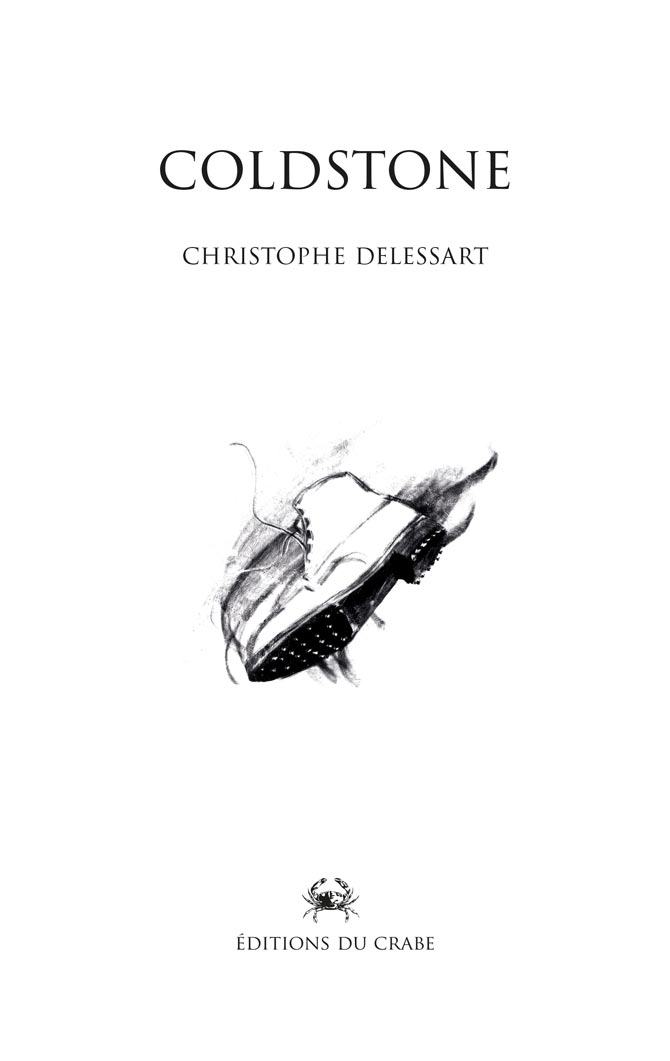Ce fut d’abord de l’eau troublée d’algues et d’argile, survolée par des oiseaux de mer, peuplée de poissons en bancs. Entre les barene, des îles, innombrables, se sont formées au gré des courants. Pour ceux de la terre ferme, elles étaient l’horizon.
De cette terre ferme sont venus un jour des hommes aux yeux clairs, lassés d’être chassés de chez eux par un ennemi puis l’autre. Ils ont travaillé à consolider des parcelles, plantant des arbres, bâtissant les îles, aménageant des repaires pour travailler la mer. Les hommes ont apprivoisé la géographie, et ont construit des villages et une ville. Des règles de vie commune, des institutions et, à chaque époque, des formes d’art qui disent la beauté du monde. Se rappelant d’où ils venaient, ils savaient qu’ils devraient se battre pour défendre ce territoire de chimère dont, jusqu’ici, personne n’avait voulu. Dès lors, le mieux était de s’adonner eux-mêmes à la conquête. Venise se fit guerrière.
Sur l’île principale, il est un quartier qui le garantit. L’Arsenal a produit les bateaux qu’il fallait pour cela. C’est un quartier populaire, où vivent pêcheurs, maçons, mécaniciens, commerçants, militaires, et quelques entreprises de haute technologie marine qui se sont installées le long de cales abandonnées. Un cœur de ville à l’écart, bien vivant.
À l’Arsenal, il y a, comme partout, un dédale de ruelles. Juste avant les lions qui le gardent, sur la gauche quand on vient du centre, au bout d’une ruelle sans perspective, se trouve une petite place. C’est le campo do pozzi, la place des puits. En fait, il n’y en a plus qu’un, témoignage du temps où ils étaient la seule source d’eau potable des Vénitiens. Ils étaient profonds, leurs parois d’argile, imperméables, consolidaient la montée de l’eau de pluie filtrée par le sable qui en tapissait le fond. Plantés au cœur des places sur lesquelles s’organisaient la vie vénitienne, d’aventures en secrets, de bavardages en calomnies, ils étaient indispensables. On en était fiers. On décorait leur margelle, c’était du bel ouvrage.
Nous y sommes. Sur cette petite place, juste en face du puits - mais à vrai dire, tout sur cette place est en face du puits - se trouve un café, tenu par un couple de jeunes femmes, d’où le nom de « café des filles » que lui donnent les habitués. C’est un peu plus qu’un café, un peu moins qu’une trattoria. On peut s’y restaurer de plats simples, mais il bat surtout son plein au moment de l’apéritif, pris en grignotant des cicchetti. Quand vient la fin de la journée, la terrasse s’étend sur presque toute la place, quelques tables et chaises en métal laissant ce qu’il faut de passage pour les habitants. Et tard dans la nuit, pour eux, on baisse un peu la voix.
Quand Laura et Chiara ont repris le café, les Vénitiens l’avaient oublié. Elles ont laissé faire le temps pour que des habitudes se prennent, pour que les paroles circulent. Elles écoutent tout mais n’en racontent rien. Elles sont infranchissables. Laura est plus vive, son cœur est au comptoir. Chiara, souvent taiseuse, administre l’affaire. Elles ont aménagé ce qui devait l’être. Le bar est large, la cuisine attenante reste fermée. Derrière la porte battante, le chef, qu’elles ont formé, d’une origine indéfinissable, à l’histoire inconnue, fait de la cuisine italienne avec des classiques vénitiens. C’est un restaurant que l’on dit ouvert. Authentique mais pas vieilli. Elles ont voulu que la salle soit assez grande pour accueillir ceux de la terrasse, qui s’y précipitent quand les pluies traversent la ville. Il y a la télé au plafond dans l’angle de l’entrée, qui ne fonctionne que pour les matches. Pas d’info en continu ici, elles sont parvenues à ce que personne ne le souhaite plus. Laura et Chiara disent en riant qu’elles ont désintoxiqué les clients, qu’elles sont un service public. Pas beaucoup de lumière du jour, les maisons à deux ou trois étages de la place, en carré serré, en limitent l’accès. Des fenêtres étroites aux petits carreaux, parfois teintés, s’éclairent de couleurs ocres et rouges le soir quand s’allument les lanternes.
Il se dit que les filles viennent de Toscane, sans doute à cause de leur parler pointu. Elles ne l’ont jamais précisé, laissent faire, parfois en riant, des suppositions farfelues. Elles sont à Venise depuis longtemps, depuis quand, on ne le sait pas. Au café, elles veulent n’être de nulle part, chacun les fait siennes, elles ne sont à personne. Elles sont jolies. Ça n’est pas pour rien, bien sûr, dans l’attachement des clients. Mais elles ont réussi à faire taire les mots et les regards insistants. L’un des clients le rappelle : « Ici on vient se reposer les yeux ». Ils sont fidèles par goût et par nécessité, c’est presque conjugal.
Quand ils se consacrent à la cérémonie du Spritz, ça peut durer. Le premier pour la soif, le deuxième pour parler, le troisième et tout devient possible, le quatrième si près de la colère, le cinquième dans les larmes. Raffaele, qu’on appelle Lele, le sait bien, qui se tient là, fumant l’air de rien.